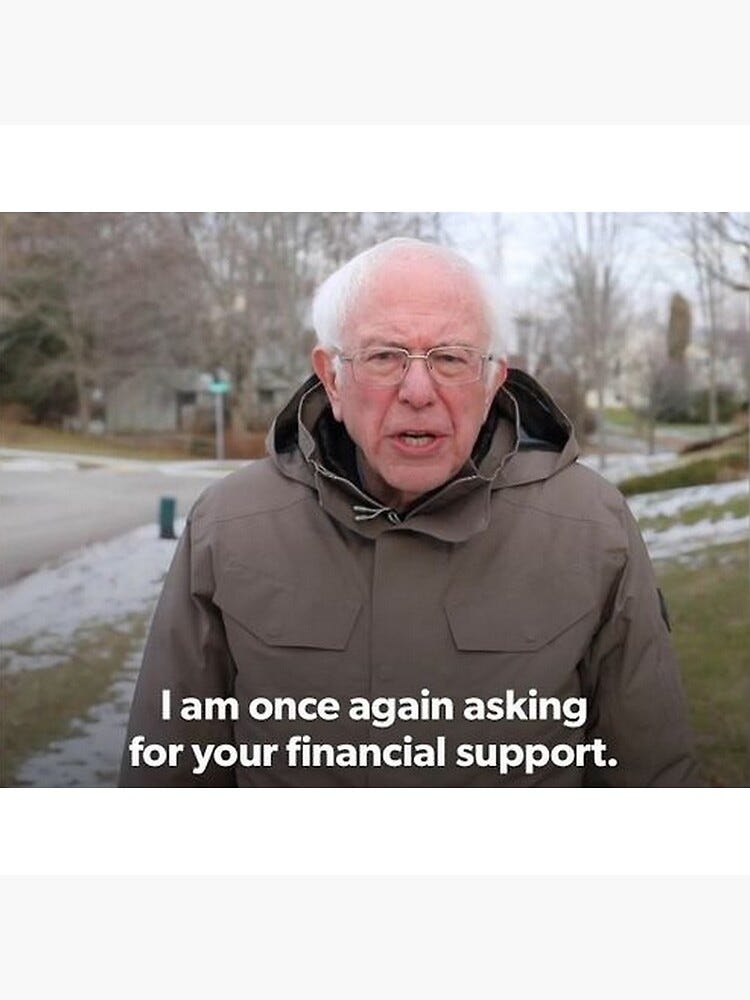L’idée n’est pas de moi. Elle vient de ma lecture du moment, Pisser dans les cours d’eau, de Serge Haston. La revue Invendable, qu’il co-édite avec plusieurs autres journalistes, raconte les dessous de leurs reportages. Tout ce qui n’est pas montré dans les articles vendus et publiés ailleurs, des voyages et des personnages qui se seraient autrement perdus entre les pages d’un carnet Moleskine.
Je pense que c’est une limite du journalisme classique: l’essentialisation des personnes que nous rencontrons. Lorsque nous les écrivons, nous les réduisons à une fonction, à une action; ils n’existent dans un article que pour illustrer un propos et c’est parfois frustrant pour moi de ne pas être capable de les décrire comme je les ai vus. L’après-publication rend les choses encore plus bizarres. Soyons francs, il est rare que nous nous revoyons autour d’un café ou d’un verre pour prendre des nouvelles. Une fois l’article paru, chacun trace son chemin - il y a bien quelques exceptions, mais elles sont trop rares. La plupart du temps, le texte publié constitue le seul souvenir qu’il me reste de mes “sujets”, encore plus si nous n’avons pas échangé nos réseaux sociaux.
Voilà d’où me vient l’envie de raconter les dessous de mes articles, même s’ils ne me mèneront pas à Pétaouchnok. J’aimerais en conserver une trace, et si elle peut en intéresser certains, c’est tout bénéf’. N’oublions pas l’aspect promo de mon travail. Tous les jeudis à 18h, Carnets de reportages se fraiera un chemin dans votre boîte mail.
Les articles desquels je raconterai les dessous ne seront pas forcément des reportages, mais “Carnets d’articles” c’est quand même beaucoup moins stylé.
La boxe, dernière chance des rebuts de l’école chinoise
(c’est le souvenir que j’ai du titre final, pas sûr qu’il soit très fiable…)
En 2014, c’est la fin du lycée. J’ai mon bac en poche, et comme tous les étés, mon père a pour projet de me ramener en Chine pour voir la famille. Une sorte de rituel de vacances. D’habitude, nous nous posons quelques jours à Xi’an, d’où mon père est originaire (voir le précédent Carnet de reportage), et nous bougeons tous les deux ailleurs dans le pays, au gré de nos envies. Nous allons à Canton voir André, un copain d’université du daron, ou au Tibet, pour récupérer des documents administratifs datant de l’époque où il y vivait. Lorsque ma mère nous accompagnait encore, nous avons visité la Mongolie intérieure, le désert de Gobi, le monastère Shaolin… Mon père en guide - il a exercé cette activité professionnellement pendant plusieurs années. Mais voilà, cette année-là, il sera très pris par le travail: impossible de me baby-sitter. Pour mes cousins et cousines, l’été ne rime pas avec vacances, mais avec perfectionnement. Perfectionnement en maths, en anglais, en chinois… L’équivalent chinois du bac arrive bientôt, et leurs parents veulent s’assurer qu’ils soient le mieux préparés possibles. De trop mauvais résultats leur fermeraient la porte de la plupart des universités, synonyme pour mes tantes et oncles de rater sa vie. Les parents mettent énormément de pression sur leurs enfant pour qu’ils réussissent leur gaokao. C’en est presque une question d’honneur.
L’année d’avant, on m’avait inscrit dans un institut pour apprendre le chinois. J’y passais la journée et quelqu’un venait me chercher en fin d’après-midi. J’avais vécu de bons moments avec les autres élèves internationaux - c’est avec eux que j’ai pris ma première bière ! - mais l’idée de gâcher une partie de mon été enfermé dans une salle de classe me déprime. « Est-ce que ça te dirait d’apprendre le wushu ? », me demande mon père. « Je connais quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaît (…) le coach de l’équipe de sanda de Xi’an. L’été, ils proposent des camps d’entraînement ouverts à tous. Tu passes la journée là-bas et je viens te récupérer le soir. Qu’en dis-tu ? »
Ma pratique sportive d’alors se limite à une barre de traction installée dans ma chambre et un usage quotidien de la souris et du clavier en ranked de League of Legends. Clic clic clic clic. Très franchement, mon état physique est déplorable. Je ne peux pas courir dix minutes sans cracher mes poumons - en plus, je suis asmathique, alors imaginez, mes poumons remontent littéralement dans ma gorge lorsque je tousse - et le dernier sport que j’ai pratiqué doit être l’aïkido - pas vraiment connu pour son intensité. Un camp de boxe d’un mois un Chine ? Mais quelle bonne idée ! Je ne sais plus exactement ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais j’accepte. Esprit shonen, et puis j’ai l’âge où en tant que mec, on se dit qu’on peut battre n’importe qui à la bagarre. (Si quelqu’un mentionne Kaizen, je lui arrache la tête). Quelques semaines plus tard, je me retrouve donc à 8 000km de chez moi, sur la piste de course d’une sorte d’Insep régional, nouvel ajout à la meute parmi des boxeurs qui passent littéralement leur vie ici.
Il est 8 heures du mat’, le soleil tape déjà bien fort. Dans le groupe, quelques garçons courent à reculons en me dévisageant. Je dois déjà être en train de respirer fort. Mon père discute avec l’entraineur, sur le côté de la piste. Je ne sais pas ce qu’ils sont en train de se dire, mais je le vois s’agiter dans tous les sens. J’imagine que mon père lui explique qu’il pratiquait le wushu quand il était plus jeune et que nous voir courir comme ça lui rappele sa jeunesse. À en juger par l’expression impassible du coach, cet énorme frigo d’1m95 aussi imposant qu’un 4x4, il n’a pas l’air de porter beaucoup d’intérêt aux anecdotes du paternel. Ils ont pourtant l’air d’être de la même génération.
Dans le groupe qui court autour de la piste, tout le monde a la même tenue: un short de boxe bleu ou rouge à la ceinture jaune, et un débardeur de la même couleur que le short. À part moi, en “habits de civil”.
Le premier à me parler s’appelle He Shao Shuei. Il court à reculons en me posant des questions - en chinois, bien sûr - pendant que je peine à suivre le rythme pépère qu’ils m’imposent. He Shao Shuei a une tête qui ne s’oublie pas, plate et allongée, il ressemble au roi singe Sun Wukong du Pèlerinage vers l’Ouest. Il y a quelque chose de très malicieux et joueur sur son visage. Il me demande d’où je viens, je lui réponds de France, et tout de suite, son visage s’illumine. « Apparemment les femmes en France sont magnifiques ! Tu pourras m’en présenter ? » Il se fait reprendre par un des donneurs d’allure, en tête du groupe, un mec qui me fait un peu flipper de prime abord, crâne tout rasé, physiquement imposant, le visage fermé. Et puis finalement, lui aussi se met à rigoler et à me demander des trucs sur les meufs en France, des trucs que je ne comprends pas très bien. Je rigole avec eux de bon cœur, même si je ne pige que la moitié de ce qu’ils racontent.
Midi arrive. Nous montons avec mon père dans la chambre du coach Song pour finaliser l’inscription. Je crois que nous lui avions ramené un cadeau, une bouteille de vin français. Le coach Song l’a acceptée en tirant une moue. J’avais mis ça sur le compte de son caractère de cochon, mais j’ai appris plus tard qu’il essayait de se sevrer de l’alcool. Dans l’intimité de sa chambre, qui lui sert aussi de bureau, je crois qu’il nous a raconté une histoire assez dure, mêlant alcoolisme et tragédie personnelle, mais je ne m’en souviens plus très bien. C’est un homme assez bourru, élevé dans la plus pure tradition chinoise, délire mâle alpha, on ne pleure pas, on ne montre pas qu’on souffre etc… mais il semble brisé par quelque chose. Pour être franc, sur le moment, il me fait juste flipper avec son visage aux traits tirés vers le bas, sa mâchoire aussi carrée que ses épaules et ses paluches de titan. Après ce rendez-vous, je rejoins le groupe qui nous attend tandis que mon père file.
Mes nouveaux amis et moi nous dirigeons vers le réfectoire, et je m’aperçois que je suis particulièrement choyé par rapport aux autres “nouveaux”. Eux se font bizuter sévère. On les envoie acheter des boissons à la supérette, on pique dans leur assiette, on leur tire les cheveux, on les pousse… Ambiance lycée américain. Heureusement, ils n’ont pas l’habitude de parler à des étrangers, alors ils me prennent sous leur aile. J’avoue ne pas me plaindre du traitement de faveur. En contrepartie, je leur montre des photos de Paris, leur raconte ma vie en France, leur parle de ma copine - et de ses copines.
Le coach Song. Je crois qu’il n’était pas très à l’aise avec les photos. Si j’avais braqué mon objectif sur lui quelques secondes de plus, j’ai le sentiment qu’il m’aurait démarré.
Après manger, nous allons dans les chambres. C’est l’heure de la sieste. Étant externe, je n’ai pas de lit là bas. Les chambres sont petites, environ 9m², et contiennent entre quatre et six lits superposés, alors on me trouve une place comme on peut: parfois, je partage un matelas, d’autres fois, un des gars est suffisamment sympa pour carrément me laisser sa place. Pendant ce temps de repos, nous essayons de trouver des sujets en commun. Ils se trouvent qu’eux aussi sont de gros joueurs de League of Legends, ils se relaient sur le seul PC portable du dortoir. Alors on discute du jeu, des championnats du monde, des résultats de l’équipe chinoise… Un des types est tellement fan de League of Legends que pour le reconnaître, j’ai enregistré son contact en tant que “géant qui joue à LoL [League of Legends]”. Je ne sais plus comment il s’appelle.
J’avoue avoir du mal avec les prénoms en général, j’ai besoin de les voir écrits plusieurs fois pour les mémoriser, et ce n’est pas une spécificité des prénoms chinois, ça arrive aussi avec les français. Lorsque j’ajoute les gars sur WeChat, je leur demande toujours de m’écrire leur nom en pinyin, l’écriture chinoise qui utilise nos caractères, pour bien imprimer, parce que sinon, dans une phrase type “ok, du coup moi c’est machin”, je n’arrive pas à dissocier le patronyme du reste des mots.
Lorsque le réveil sonne, nous émergeons de notre sieste. Certains ont le sommeil plus lourd que d’autres, il faut les secouer pour les réveiller. J’ai l’impression d’être déjà complètement intégré au groupe. Je traîne des pieds avec eux pour rejoindre la salle de boxe. L’endroit semble tout droit sorti d’un autre temps. Les poids sont rouillés, les sacs réparés au scotch, des banderoles rouges criardes aux slogans “motivants” pendent sur les murs…
Nous débutons l’échauffement dirigé par Hu Se Le, un boxeur d’origine mongol numéro 1 de sa catégorie en Chine - je l’ai d’ailleurs enregistré sur mon téléphone sous le pseudonyme “China’s #1”. Le coach Song nous rejoint un peu plus tard. Lui aussi semble avoir du mal à se remettre de sa sieste. Il me file mon équipement, encore sous plastique: des bandes à enrouler autour des mains, un short rouge, un débardeur rouge et une paire de gants de la même couleur. Le kit du débutant. Et pendant que les autres enfilent gants et pattes d’ours, le coach Song nous dit, à quelques autres débutants et moi, que nous commencerons devant le miroir. Sous la supervision d’un “aîné” (je crois que je suis l’un des plus âgé du groupe), qui nous montre comment nous positionner et donner un bon direct du gauche et du droit, nous répétons des dizaines, des centaines de fois “direct du gauche, direct du droit”. Il faut bien fermer le poing, s’imaginer taper avec la tête des métacarpes et taper légèrement en descendant, presque comme une griffure. C’est comme ça que j’apprends à différencier ma gauche de ma droite, et que je les intègre à mon vocabulaire chinois. Zou, you.
Ce que nous pratiquons ici s’appelle du sanda, de la boxe chinoise. Loin du wushu, qui ressemble plus à une chorégraphie - ce dont mon père était familier -, il s’agit d’une vraie discipline de boxe pieds-poings-projections, où les coups sont réellement portés et non mimés. Ces gars-là sont des vrais combattants qui vivent au rythme des entraînements et des compétitions. Ils me montrent leurs combats sur leur téléphone, et on sent qu’ils sont là pour arracher la gueule de leur adversaire, pas juste “pour le sport”.
Le type à ma droite n’est arrivé ici que depuis quelques jours. Je ne me rappelle plus comment il s’appelle, mais je me souviens encore de ses pommettes qui mangent ses yeux lorsqu’il sourit. Je l’ai vu se faire malmener à la cantine sans opposer plus de résistance qu’une moue résignée. À côté de lui, un autre jeune à la coiffure Justin Bieberesque, la mèche tombant sur son visage comme un acteur de k-drama. Il a un visage doux, l’air un peu lent comme son voisin, tout l’inverse de He Shao Shuei qui semble carburer à dix-mille à l’heure, comme s’il tapait des traces pour tenir le rythme. À la fin de l’entraînement, mes deux camarades regagnent timidement leur chambre tandis que He Shao Shuei, Hu Se Le et Sun Gao, les “cool kids” du groupe, viennent me rejoindre. Ils veulent m’apprendre quelques gros mots de chinois, discuter encore de la vie en Europe, et toujours me parler des filles. Ils rêvent de marier des top modèles. Pendant que nous échangeons, Sun Gao me fait une démonstration de wushu traditionnel. Comme un acrobate de cirque, il enchaîne les cabrioles, les sauts, les saltos… ce qui m’impressionne particulièrement.
Au milieu, Sun Gao. A droite, en rouge, l’un des bizuts qui s’entraînait avec moi devant le miroir. Je ne me rappelle plus exactement du type à gauche, mais il me semble qu’il était très sympa aussi.
À la fin de l’après-midi, mon père vient me chercher. Je suis trempé de sueur: la chaleur de Xi’an est étouffante et il n’y a pas de climatisation dans le gymnase. Je dis au revoir à mes nouveaux amis et monte dans le taxi du retour, dégoulinant sur la banquette arrière. Heureusement qu’elle est recouverte d’une housse en tissu.
Le lendemain, mon père propose que nous courions pour nous rendre au complexe sportif. Trois kilomètres séparent notre lieu de résidence du gymnase, et une promenade urbaine a été aménagée le long de l’avenue qui relie les deux. Je peine à tenir la distance.
Mon père me laisse devant la grille. Ce petit footing l’a bien réveillé. Moi pas trop. Il monte dans un taxi, je suppose qu’il rentre à l’appartement pour se débarbouiller avant d’aller à son rendez-vous professionnel. Il est encore tôt. Je rejoins le groupe qui descend du dortoir. Tout le monde a l’air un peu endormi. Dans un silence relatif, nous traînons des pieds jusqu’au gymnase. À cette heure-ci, tous les autres sportifs du complexe commencent aussi leur entraînement. Nous voyons les haltérophiles entrer dans la salle d’en face, les gymnastes monter les escaliers, les pratiquants de wushu s’installer dans le bâtiment adjacent... Lorsque nous avons fini l’échauffement, le coach Song nous rejoint en baillant très fort, un vrai ours. Je me retrouve à nouveau devant le miroir avec mes deux comparses à répéter les mêmes mouvements. À midi, nous allons manger au réfectoire. Nous montons ensuite dans les dortoirs pour faire une sieste digestive. Retournons au gymnase après nous être réveillés. Et la journée se termine.
Parfois, l’entraînement de l’après-midi se fait autour de la piste. Il aussi arrive que le coach ouvre la salle de muscu, un coin reclus du gymnase où la lumière n’ose pas se mettre les pieds. Nous nous relayons sur le banc pour pousser de la fonte rouillée. Plus rarement, nous sortons sur le terrain de foot et le match que nous jouons fait office d’entrainement.
Le week-end, je reste auprès de ma famille. Lundi matin, je suis à nouveau au gymnase.
Trois semaines s’enchaînent à ce rythme. Je pense avoir fait semblant d’être malade une ou deux fois, trop fatigué pour sortir du lit.
Le camp ferme ses portes une semaine avant mon départ. La plupart des boxeurs retournent se reposer dans leur famille pour passer le mois qui arrive.
Je suis dégoûté. Je dis au revoir à mes nouveaux amis. On se promet de garder contact, on se prend dans les bras comme à la fin d’une colo, dans une ambiance de fraternité presque surjouée. Un des bizuts prend une photo de groupe où nous sautons tous ensemble. Je change ma photo de profil sur WeChat pour mettre un selfie pris avec He Shao Shui. Il me dit de revenir quand je veux, que je suis le bienvenue ici, et que la prochaine fois, nous irons boire, manger et chanter au karaoké.
Pour ma dernière semaine en Chine, mon père m’inscrit dans une nouvelle salle de sanda, des cours donnés au Staps de Xi’an. Les séances ont lieu le soir et les pratiquants sont moins “tryhards”, enfin, pour la plupart. Je me rappelle de ce type, à peine plus jeune que moi, avec qui j'avais marché jusqu’à l’arrêt de bus après la boxe. Il m’avait avoué être gay, en chuchotant, et ses parents, pensant qu’il était trop “femmelette”, l'avaient inscrit à la boxe pour qu’il apprenne à “devenir un homme”. Il avait horreur de ça, et contrairement aux autres, ne prenait aucun plaisir à donner et recevoir des coups. Pendant longtemps, je l'avais complètement oublié. C’est en écrivant ce carnet de reportage que l’anecdote me revient. Je le revois me raconter ça, dépité, avec ce sourire du mec qui veut rire pour dédramatiser d'une situation franchement pas marrante.
À la fin de la semaine, l’un des instructeurs me propose une opposition. J’accepte, tout excité à l’idée de mettre en pratique ce que j’apprends depuis un mois. Le mec que je dois affronter fait deux fois mon gabarit, a plusieurs combats à son actif, c’est un peu le chouchou de la salle. J’ai l’impression d’être donné en pâture à un tigre… et je n’ai même pas de protège-dents ! (Les pratiquants de boxe savent à quel point c’est important. J’ai déjà perdu un bout de dent en boxant sans, mais c’est une autre histoire. ) Je tourne autour du type en lui donnant quelques pichenettes, comme un moustique autour d’un taureau. Jusqu’à ce qu’il s’énerve et me mette une combinaison de trois coups secs dans la tronche. Bam bam bam. J’ai l’impression que mon pif vient de se faire exploser à la TNT. C’est les chutes du Niagara dans mon nez, l’entraineur arrête tout de suite le sparring. Sur la vidéo, on me voit faire un signe d’incompréhension avec les mains, genre “hein? Mais non, je peux continuer !” alors que mon nez me faisait un mal de chien et que je me serai fait encore plus malaxer si j’avais persisté.
Nous sommes la veille de mon retour en France. Toute la soirée, je me triture le nez en pensant que je me le suis cassé.
L’année d’après, je retourne au camp du coach Song. Cette fois-ci, nous lui ramenons un cadeau non alcoolisé. Il a l’air beaucoup plus détendu, il sourit, et nous rejoint parfois dans la salle aux poids rouillés pour pousser de la fonte. Je rencontre de nouvelles têtes venues pour perdre du poids. Les deux bizuts qui s’entraînaient devant le miroir avec moi sont restés toute l’année là-bas. Ils sont devenus bien balèzes, je n’ose même plus les taquiner. Je retrouve Hu Se Le, Sun Gao et He Shao Shuei. Ils se sont tous reconvertis dans le MMA, parce que le sanda ne paie plus. Le type au crâne luisant est parti, il s’est fait embaucher par une boîte de sécurité privée. Sur WeChat, il continue de poster des vidéos de lui en train de boxer.
Ma première année au camp
La deuxième année. On est pas trop pipou kawaii ??
À mon retour à Paris, je cherche à vendre un sujet sur ces boxeurs chinois. Je suis toujours à l’école et j’ai la bonne idée d’essayer de gratter des mois de stage en valorisant mes piges. « Mais si je vous jure Mr. le directeur ! J’ai pris deux semaines pour faire cet article, vendu et publié dans tel magazine. Est-ce qu’on ne peut pas déduire ce temps de travail de mon stage ? » Le pire, c’est que ça marche. J’en vends un, deux, trois, dans le but de passer l’été prochain pépère, à la plage, les doigts de pied en éventail.
Pour faire accepter ce sujet, j’accentue la dimension sociale. Ça donne quelque chose comme “la boxe, dernière chance des enfants chinois qui ne réussissent pas à l’école”. Car Hu Se Le, Sun Gao et He Shao Shuei sont tous des cancres dans un monde de premiers de la classe. C’est pour ça que leurs parents les ont envoyés ici, dans le camp du coach Song, la boxe école en dernière chance. Le magazine en ligne de reportages internationaux 8e étage me le prend, et pour la troisième année consécutive, je retourne dans le camp d’entraînement du coach Song, cette fois-ci avec un calepin, un stylo et un appareil photo.
Malheureusement, 8e étage a fermé depuis. Le reportage est introuvable sur internet, mais j’ai mis la main sur une pseudo version définitive. Il me semble que le texte publié avait connu quelques ajustements de la part du rédacteur en chef, Maxime Lelong. Mais dans les grandes lignes, c’était le même reportage que vous retrouverez à la fin de ce Carnet.
Je retourne en Chine cet été pour la première fois depuis 4 ans. J’espère avoir l’occasion de recroiser certains de mes camarades.
Edit 05/04/2025, 00:51 : ajout du paragraphe sur le boxeur homosexuel dont les parents l’ont forcé à s’inscrire à la boxe.
Le sport, porte de sortie de l’école chinoise
Avec un des systèmes scolaires les plus élitistes au monde, les étudiants chinois sont mis à rude épreuve. Pour ceux qui ne s’adaptent pas au modèle, les portes de l’éducation se referment dès le collège. Victimes de l’hyper sélectivité, certains jeunes sont envoyés par leurs parents dans des camps d’entrainement pour devenir des sportifs de haut niveau. Une éducation coup de poing.
Le petit matin se lève sur le camp de formation sportif de Xi’an. Ils sont une vingtaine à trainer les pieds dans la poussière. Les yeux encore à moitié collés, ils baillent chacun leur tour. Ce sont les combattants de l’équipe de sanda - variante chinoise du kickboxing- de la province du Shaanxi. La plupart portent une tenue d’entrainement classique. Un t-shirt sans manche – rouge, bleu ou noir- floqué d’un dragon doré dans le dos, et un short court. Comme tous les jours, ils se dirigent du dortoir au gymnase, dans un concerto de claquettes contre bitume. 10 petites minutes d’une marche lente, presque forcée, qui leur permet de se préparer mentalement à l’entrainement du jour.
Les bâtiments de cet Insep à la chinoise sont simples, voire vétustes, et très peu colorés. Ce qui contraste avec les énormes tours de verre du quartier d’affaires. De l’autre côté du trottoir, les costards-cravates se dépêchent de gagner leurs bureaux. Ils passeront sans doute leur journée entre réunions, comptes-rendus, mails, et pauses café clope. Pour prétendre à la vie rêvée du salarié, ces cadres supérieurs ont dû passer par l’enfer du système éducatif chinois. Une pression constante, une sélection sans pitié… Des raisons suffisantes pour que Libo Wei sorte du circuit scolaire à 15 ans, quelques années avant de passer son bac. « J’avais des mauvaises notes, je n’aimais pas étudier dans ces conditions », se justifie-t-il. Légèrement en surpoids, il prend alors la décision avec ses parents d’intégrer l’équipe de boxe chinoise de la région. Niveau finances, il estime qu’une année dans le camp équivaut à 1000 ou 2000 yuans, contre 3000 ou 4000 pour le collège. De quoi alléger largement les dépenses de la famille, bien que le jeune homme assure que ce n’était pas une question d’argent. « Je voulais vraiment arrêter d’étudier », martèle-t-il.
Les cheveux fraichement coupés au bol, Sun Gao vient de souffler sa 18 ème bougie. Ne dépassant pas le mètre 65, ses épaules sont carrées et ses bras gonflés. Il est un des piliers de l’équipe. Ça va faire 10 ans qu’il s’entraine ici. « L’école coûtait chère, et avec mes résultats, ma famille ne pouvait pas se permettre de prendre de risque. Mes parents m’ont envoyé faire de la boxe chinoise quand j’étais très petit », raconte-t-il. Un destin qu’il embrasse aujourd’hui sans regret. « Je ne leur en veux pas du tout», confie-t-il.
« Je veux partir étudier à l’étranger »
Pourtant, la vie ici n’est pas facile. L’année dernière par exemple, il a dû lutter pour rester au poids. « C’était 3-4 jours avant une compétition importante. Il faisait 40°, sous un grand soleil. J’étais 5kg au-dessus de ma catégorie. J’ai donc passé la semaine à faire des tours de stade en portant plusieurs couches de vêtements. » Toutes les heures, il revenait au gymnase pour essorer les 4 vestes qu’il avait sur le dos, et repartait de plus belle.
Jours après jours, ces jeunes s’entrainent de 8h30 à 12h30, avec pause de 2h le midi. Puis rebelote l’après-midi jusqu’à 18h. Le soir, c’est quartier libre, même s’ils ont quelques fois des entraînements spéciaux jusqu’à 22h. Le dimanche, ils profitent d’une journée pour respirer. Le résultat d’un tel emploi du temps ? Des courbatures permanentes et des blessures en tout genre. Bleus sur les jambes, douleurs articulaires, le fardeau physique paraît plus lourd à porter que la pression scolaire.
Mais pour Libo Wei, il était hors de question de faire marche arrière. Même aujourd’hui, après avoir passé 4 années dans le camp, retourner dans le système scolaire chinois lui semble impensable. « Là, j’apprends l’anglais dans un institut privé pour pouvoir partir étudier à l’étranger l’année prochaine. J’aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande », confie-t-il dans un anglais plutôt limpide.
Si on pourrait croire les rebus de l’école chinoise nombreux, Sun Gao assure qu’ils ne le sont pas tant que ça. En termes de pourcentage en tout cas. « Mais avec toute la population qu’il y a en Chine, ‘’pas nombreux’’, ça reste un nombre plutôt conséquent », analyse-t-il.
Après l’effort…
La fin de l’entrainement matinal pointe le bout de son nez, et les ventres n’en finissent pas de gargouiller. Direction la cantine. Mais avant, Sun Gao s’arrête à la supérette avec son ami. « La bouffe d’ici est vraiment pas bonne », admet-il en sirotant son Meidon, sorte de Volvic Juicy local. « Le soir on en profite pour sortir au restaurant manger de la vraie nourriture. C’est comme ça qu’on fait du bon muscle ! », explique-t-il, tout sourire, en contractant son biceps. Il faut dire que la cantine n’est pas très attirante. Les plateaux en métal où sont servis les repas font penser à ceux qu’on retrouve en prison. Au menu du jour : patates, riz, haricots, et quelques morceaux de poulet. Un classique.
Attablé avec ses camarades, Sun Gao finit son met en quelques minutes à peine. Ils débarrassent et retournent dans le dortoir. Jusqu’à 14h, c’est repos. Les petites chambres de 10m² accueillent parfois jusqu’à 6 lits. Celle de Sun Gao est un peu en désordre. Sur le petit balcon, des habits sont en train de sécher au soleil. Un peu gêné de recevoir dans ces conditions, il s’excuse, puis va prendre sa douche.
Si cette jeunesse passe quasiment tout son temps à s’entrainer, elle partage pourtant les mêmes hobbies que les autres chinois. Le très célèbre jeu League of Legends, par exemple. « Il y a deux ans, on a suivi à fond la coupe du monde de LoL. On était à fond derrière World Elite (ndlr : la seule équipe chinoise représentée). Mais les Coréens sont beaucoup trop forts », se rappelle Sun Gao, en train de se sécher. A cette époque, ils faisaient tourner un petit PC portable pour tout l’étage. Aujourd’hui, c’est sur mobile qu’ils jouent. Heartstone, Clash Royal… Ils se partagent toujours des vidéos de LoL.
« Regarde cette action de Faker, c’est dingue ! » s’étonne le jeune boxeur. Après ce petit moment passé sur Youku, le youtube chinois, les jeunes retournent dans leur lit – une planche de bois posée sur une structure métallique. C’est l’heure de la sieste.
Gagner son pain à la sueur de ses poings
Une chose est sûre, ils ne roulent pas sur l’or. Ça n’a pas empêché He Shao Shuei, l’une des stars de l’équipe, de verser 2200 yuans (l’équivalent d’un SMIC) à une œuvre caritative. « Il y a eu un séisme au Sichuan, un qui a fait une vingtaine de morts. J’avais un peu de sous de côté, je me suis dit que je devais faire au moins un geste… », justifie-t-il. Lui a déjà un bel avenir de tracé dans le MMA.
« Certains boxeurs d’ici sont entrés dans l’octogone parce qu’il y a moyen de se faire beaucoup d’argent. En tout cas, plus qu’en boxe chinoise. », éclaire Sun Gao. Les compétitions sont leur unique source de revenus. « En Chine, le sanda ne suffit plus pour gagner sa vie », déplore le boxeur à la coupe au bol. Si le sanda est très ancré dans les traditions chinoises, il commence à être supplanté par les superproductions américaines de l’UFC. Plus suivi, plus lucratif, le mixed martial arts a trouvé son public en Chine.
Pour aller chercher des combats, il faut parfois traverser les continents. Il y a quelques mois de ça, Deng Ming est allé jusqu’en France pour un combat de kickboxing. Il en est revenu avec des étoiles plein les yeux. Non, ce n’est pas la Tour Eiffel ni les Champs qui l’ont autant ému. Ce sont les filles.
« A Paris les filles étaient vraiment super belles, c’est dingue. Partout où tu vas y’a forcément un canon. », se souvient-il.
Sun Gao se rappelle de deux de ses anciens camarades. « Il y a 3 ans, il y en a un qui a été recruté par une boîte de sécurité privée, loin d’ici, dans le Yunnan si je me souviens bien. (NDLR : province du sud ouest frontalière avec le Vietnam). Et l’année dernière, un autre est parti rejoindre l’armée. » Il faut dire que ces profils atypiques intéressent beaucoup les recruteurs. Très sportifs, il ne leur faut souvent qu’une petite formation théorique supplémentaire pour exercer ce type de métier. Mais ce genre de carrière n’intéresse pas notre boxeur à la coupe au bol. Pour lui, l’année prochaine, direction l’université d’éducation physique de la ville de Xi’an (l’équivalent de STAPS). D’ailleurs, il vient de recevoir sa lettre d’admission. « 10 ans plus tard, je suis de retour dans le système ! »